Titre: La Ballade de Narayama Année de sortie:1983
Directeur: Shohei Imamura Pays d’origine: Japon
Durée: 2h
Fait additionnel: A gagné la Palme d’or au Festival de Cannes en 1983
Le milieu est d’une précarité mythologique. La prérogative suprême est cette sainte nécessité qu’on appelle “ce qui doit être fait pour survivre”. Dans ce village japonais de l’ère Edo, la vie est rythmée par les caprices des récoltes et le cycle intransigeant des saisons. La tradition qui y règne est impitoyable: à l’aube de son 70e hiver, l’aîné de la famille doit abandonner son parent au sommet d’une montagne de sorte à ce qu’il puisse y puiser le reste de ses jours. Tous ne s’y résignent pas, mais chacun y est contraint. Dans le cas de la vieille Orin, à une année ou presque de franchir ce cap, c’est ce même sort qui lui est immanquablement réservé. Mais avant, elle doit s’occuper de trouver une femme à ses trois fils…
La destinée humaine est inexorablement ballotée à la fatalité. Cette fatalité est ensemancée dans la terre et la crasse, elle est le pendant à tout ce qui va de mise avec notre existence corporelle: la faim, le sexe, la violence, cette force somatique qui s’empare de nous et nous pousse à lutter, continuellement, pour survivre un autre jour. C’est l’une des thématiques principales du film, qui nous montre finalement comment accepter la mort.
Les villageois sont dépeints comme vivant dans une austérité extrême. Leurs objets de préoccupation ne se rapportent vraiment qu’aux essentiels de leur existence. Il y a chez eux une profonde conscience de la mortalité, toujours imminente. L’époque où chaque grossesse pourrait signer l’arrêt de mort de la mère ou du nouveau-né. L’époque où une récolte catastrophique pouvait mettre fin à une lignée toute entière. L’époque où une grippe représentait une condamnation débilitante à une vie d’alitement. Mais malgré tout, il y a des moments de joie et de candeur, aussi simples ou brefs qu’ils soient. La misère n’est pas pornographique. Je pense à cette comptine chantée par les enfants du village aux dépens de la vieille Orin, ou bien de la scène où le fils le plus jeune d’Orin tente de charmer une fille d’un village voisin dans la forêt.
C’est un portrait d’une communauté agrarienne aux mœurs simples. Ce sont des gens hardis, farouches, superstitieux. C’est un portrait qui tire pratiquement de l’anthropologie. Tout est dépeint dans un naturalisme profond, avec grivoiserie en un temps et lourdeur de l’autre. Les images sont très crues. Cependant, l’intention n’est pas de simplement déranger, il me semble, plutôt, elle consisterait à mettre à nue la nature humaine dans tous ses états, à tracer un portrait d’une proto-humanité déliée de nos préjugés moraux modernes.
Je crois que cette œuvre spécifiquement capture le mieux la tonalité (un peu discordante dans “L’Anguille”) des films d’Imamura. Un moment, une scène humoristique avec un homme surnommé “le Puant” par ses pairs, dont l’odeur corporelle est si repoussante qu’il est catégoriquement rejeté par toutes les femmes du village, qui se résigne alors à se soulager dans une chienne, et puis l’autre instant, un familicide. Étonnamment, je crois que tout s’enchaîne de sorte à former un assemblage cohérent cependant.
La sensualité joue un rôle significatif dans l’œuvre. Le sexe surtout. Avant de faire le pas vers l’autre côté, Orin doit aussi marier ses 3 fils. Il y a une intrigue romantique entièrement dévouée au Puant (le fils cadet d’Orin) qui trouve sa conclusion chez une septuagénaire qui a perdu son odorat. Le climat est profondément patriarcal. Par crainte d’une malédiction ancienne, un père ordonne sa fille, comme dernières volontés, à se coucher avec tous les hommes célibataires de son village. Elle finit par se borner entièrement ou presque au souhait de son père, exception faite pour le Puant.
Après avoir sérénadé la fille d’un village voisin dans les bois, le benjamin d’Orin procède à la forniquer (dans un contexte de consentement douteux). S’ensuit un déchainement de passions charnelles très animal, entrecoupé de plans d’insectes copulants et de motifs zens-bouddhistes. C’est comme s’il était fondamentalement dans l’ordre de la nature de vouloir subjuguer à sa volonté, que la domination patriarcale et la coercition étaient des aspects inévitables de la reproduction pour l’homme. C’est l’étude anthropologique sous-tendue par cette fascination proprement japonaise pour l’entomologie. C’est la volonté de pouvoir, de se reproduire, à l’échelle de la grande chaîne de la vie; de l’insecte le plus abject à l’homme. Mais surtout, la scène nous rappelle que l’on regarde un film d’art-house japonais.
Le film se solde par ma séquence préférée,, évocatrice de certains films de Werner Herzog. Les dialogues se mettent de côté pour céder à la contemplation des paysages montagneux, très bucoliques, et l’acceptation farouche de la mort. Après avoir assuré la survie de ses enfants pour l’hiver, avoir marié son ainé et contribué à la mort de la femme de son plus jeune dans un épisode de violence collective traumatique, Orin est prête à embarquer dans le sentier qui la mènera à la mort. Avec une sérénité profonde, elle se laisse emporter par son premier-né (joué par Ken Ogata, connu en Occident pour avoir incarné Yukio Mishima dans le film de Paul Schrader du même nom) vers le haut de la montagne. Le chemin est ardu, le périple long. Parler à son fils lui est strictement proscrit. À chaque tentative de dissuasion de ce dernier, la volonté de la mère demeure intransigeante. Ce n’est pas une résignation nihiliste face à l’existence qui la (dé)motive cependant, c’est un sens du devoir profond, et cette résolution d’avoir mené à bien son temps sur Terre. Arrivé au sommet, il se met à neiger. Signe de fortune pour ceux prenant part au rituel, c’est l’extase. À peine l’aîné n’arrive-t-il à se retenir les larmes: “-Regarde maman! Tu es si chanceuse! Il neige!” C’est au dernier moment de se voir que l’on veut tout se dire. Mais il est trop tard. C’est le temps des adieux. D’un balayement de la main, elle ordonne à son fils de le quitter, et ce dernier s’y oblige.
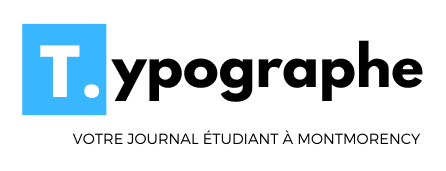
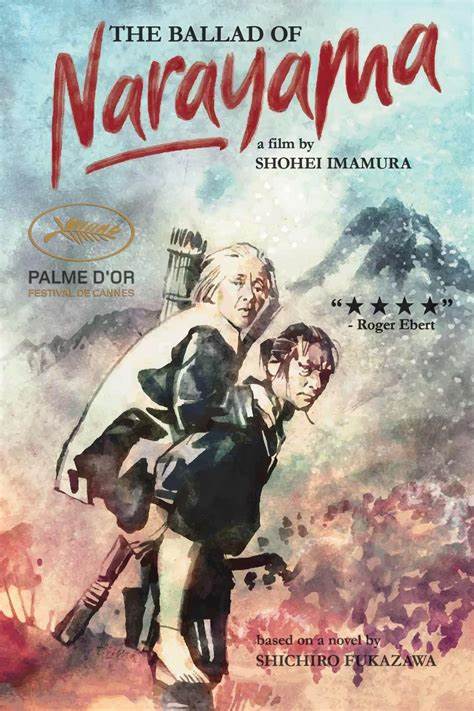
Laisser un commentaire